Tréhorenteuc, l'église du Graal

L'abbé Gillard
L'abbé
Gillard arrive dans le petit village de Tréhorenteuc (150 habitants)
lors des Pâques de 1942. Le village est enclavé dans la forêt de
Paimpont (Brocéliande).
La population est pauvre et oublie l'église.
La population est pauvre et oublie l'église.
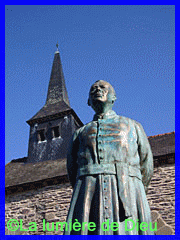
Statue de l'abbé Gillard
L'abbé
pense que sa nomination à Tréhorenteuc n'est qu'une sanction :
"L'évêché m'a envoyé à Tréhorenteuxc en pénitence" écrit-il.
Il y restera pourtant 20 années.
Il y restera pourtant 20 années.
Il est nommé recteur.
Il entreprend alors de redonner une vie spirituelle à sa paroisse.
Dès l’été 1942, l’abbé entreprend des travaux qui dureront douze ans. Il veut faire pour Tréhorenteuc un sanctuaire, mais aussi un lieu d’art, de beauté, de réflexion intellectuelle. Il envisage même la construction d’un nouvel édifice (ce à quoi l’évêché s’oppose formellement).
Dans l'église du Graal, il fusionnera la foi chrétienne, les légendes arthuriennes et les légendes celtiques. Pour cela il a trouvé un point commun entre ces 3 mondes : le graal.
En 1943, on pose le vitrail de la Table Ronde, premier pas vers la légende Arthurienne. Suivront les vitraux contant la vie de sainte Onenne, puis les statues du chœur (Onenne et Judicaël).
On enlève alors les vieux tableaux, les statues trop dégradées, les bannières qui tombent en poussière.
Mais l’église s’enrichit, à la fin de la guerre, de nouveaux autels et d’un chemin de croix exceptionnels : œuvres de l’ébéniste Péter Wissdorf et du peintre Karl Rezabeck, que l’abbé est allé chercher dans un camp de prisonniers de guerre allemands en 1945. Tous deux réalisent les œuvres en suivant les indications de l’abbé Gillard.
Après 1950, les transformations continuent : construction du mur qui sépare la nef de la « chambre du fond » (le narthex), chapitret (galerie extérieure) pour soutenir la façade. En 1951, le grand vitrail est mis en place.
Suivent en 1953 et 1954 le pavement du chœur et la mosaïque du Cerf blanc au collier d’or. L'abbé crée dans son presbytère une cantine-auberge de jeunesse.
L'abbé Gillard consacre tous ses revenus pour réaliser les travaux. Mais cela ne suffit pas.
Il fait appel aux paroissiens et aux collectivités. Le Conseil général lui alloue des subventions.
En 1948, il édite des guides consacrés à Brocéliande, à Tréhorenteuc, aux légendes de la table ronde. Puis il publie des plaquettes sur la mystique des nombres, le symbolisme du zodiaque, Carnac, etc....
Les bénéfices servent aux travaux de l'église.
Le travail porte ses fruits, on parle beaucoup de Tréorenteuc et de l'abbé Gillard. André Breton vient le visiter.
Mais bientôt les médisances et les ragots commencent. En 1962, l'abbé quitte le village et essaie de trouver en vain une paroisse pour servir.
En 1963, il demande à revenir à Tréhorenteuc mais sa hiérarchie le lui interdit, malgré les pétitions de la population et des élus.
En 1968, il revient en Brocéliande grâce à l'abbé Rouxel, curé de Néant-sur-Yvel qui l'accueille avec amitié.
Il retrouve son église et y retourne régulièrement jusqu'à sa mort en juillet 1979.
Il repose maintenant dans une des chapelles de l'église du Graal.
 La
curiosité de cette église, c'est la fusion de la foi chrétienne avec la
légende arthurienne et la légende celtique. Le point commun étant le
Saint Graal.
La
curiosité de cette église, c'est la fusion de la foi chrétienne avec la
légende arthurienne et la légende celtique. Le point commun étant le
Saint Graal.

La 9e station représente : Jésus qui tombe pour la troisième fois aux pieds... de la fée Morgane, vêtue d’une très légère robe rouge. Ce tableau valut au père Gillard de nombreuses critiques. Un quotidien régional titra : « À Tréhorenteuc, une pin-up dans un chemin de croix ».
A la 13e station, Joseph d’Arimathie recueille le sang du Christ dans le Graal.


Toujours dans le chœur, un tableau dépeint l’apparition du Graal aux chevaliers réunis autour de la Table Ronde. Il fait allusion au vieux mythe celtique du chaudron de fécondité et de vie, il remplit les assiettes de grasses volailles.



Il entreprend alors de redonner une vie spirituelle à sa paroisse.
Dès l’été 1942, l’abbé entreprend des travaux qui dureront douze ans. Il veut faire pour Tréhorenteuc un sanctuaire, mais aussi un lieu d’art, de beauté, de réflexion intellectuelle. Il envisage même la construction d’un nouvel édifice (ce à quoi l’évêché s’oppose formellement).
Dans l'église du Graal, il fusionnera la foi chrétienne, les légendes arthuriennes et les légendes celtiques. Pour cela il a trouvé un point commun entre ces 3 mondes : le graal.
En 1943, on pose le vitrail de la Table Ronde, premier pas vers la légende Arthurienne. Suivront les vitraux contant la vie de sainte Onenne, puis les statues du chœur (Onenne et Judicaël).
On enlève alors les vieux tableaux, les statues trop dégradées, les bannières qui tombent en poussière.
Mais l’église s’enrichit, à la fin de la guerre, de nouveaux autels et d’un chemin de croix exceptionnels : œuvres de l’ébéniste Péter Wissdorf et du peintre Karl Rezabeck, que l’abbé est allé chercher dans un camp de prisonniers de guerre allemands en 1945. Tous deux réalisent les œuvres en suivant les indications de l’abbé Gillard.
Après 1950, les transformations continuent : construction du mur qui sépare la nef de la « chambre du fond » (le narthex), chapitret (galerie extérieure) pour soutenir la façade. En 1951, le grand vitrail est mis en place.
Suivent en 1953 et 1954 le pavement du chœur et la mosaïque du Cerf blanc au collier d’or. L'abbé crée dans son presbytère une cantine-auberge de jeunesse.
L'abbé Gillard consacre tous ses revenus pour réaliser les travaux. Mais cela ne suffit pas.
Il fait appel aux paroissiens et aux collectivités. Le Conseil général lui alloue des subventions.
En 1948, il édite des guides consacrés à Brocéliande, à Tréhorenteuc, aux légendes de la table ronde. Puis il publie des plaquettes sur la mystique des nombres, le symbolisme du zodiaque, Carnac, etc....
Les bénéfices servent aux travaux de l'église.
Le travail porte ses fruits, on parle beaucoup de Tréorenteuc et de l'abbé Gillard. André Breton vient le visiter.
Mais bientôt les médisances et les ragots commencent. En 1962, l'abbé quitte le village et essaie de trouver en vain une paroisse pour servir.
En 1963, il demande à revenir à Tréhorenteuc mais sa hiérarchie le lui interdit, malgré les pétitions de la population et des élus.
En 1968, il revient en Brocéliande grâce à l'abbé Rouxel, curé de Néant-sur-Yvel qui l'accueille avec amitié.
Il retrouve son église et y retourne régulièrement jusqu'à sa mort en juillet 1979.
Il repose maintenant dans une des chapelles de l'église du Graal.
L’église du Graal
Nous nous sommes inscrits pour faire une balade celtique et notre guide commença la balade par la visite de l'église du Graal.

9ème station du chemin de croix
Les 12 stations du chemin de croix ont pour cadre Tréhorenteuc et le Val sans Retour. La 9e station représente : Jésus qui tombe pour la troisième fois aux pieds... de la fée Morgane, vêtue d’une très légère robe rouge. Ce tableau valut au père Gillard de nombreuses critiques. Un quotidien régional titra : « À Tréhorenteuc, une pin-up dans un chemin de croix ».
A la 13e station, Joseph d’Arimathie recueille le sang du Christ dans le Graal.

Vitrail (les chevaliers de la table ronde)

Vitrail (Joseph d'Arimathie agenouillé devant Jésus)
On
retrouve le Graal sur trois vitraux du chœur. Il figure sur la table de
la Cène, apparaît aux chevaliers de la Table Ronde, et il rayonne
enfin au centre du grand vitrail du chœur, au-dessus de Joseph
d’Arimathie agenouillé devant Jésus et des symboles traditionnels des
évangélistes. Toujours dans le chœur, un tableau dépeint l’apparition du Graal aux chevaliers réunis autour de la Table Ronde. Il fait allusion au vieux mythe celtique du chaudron de fécondité et de vie, il remplit les assiettes de grasses volailles.

Tableau
Les
deux autres tableaux du chœur rappellent les grands thèmes légendaires
de Brocéliande. Autour de Barenton s’ordonnent Yvain et le bassin d’or,
Viviane enchantant Merlin, Ponthus combattant pour la main de la belle
Sidoine, et Éon de l’Étoile. Au Val sans Retour, Lancelot et Morgane se
défient, entourés des chevaliers prisonniers. 
La mosaïque du cerf
Enfin,
la mosaïque du Cerf blanc au collier d’or, dessinée par Jean Delpech,
témoigne une fois de plus de la fusion entre la spiritualité chrétienne
et l’esprit des vieux romans celtiques. Le Cerf blanc et les quatre
lions rouges illustrent un épisode de la Quête du Graal où Galaad
aperçoit ces animaux surnaturels qui se révèlent être Jésus et les
évangélistes. Dans les textes arthuriens, le Cerf guide parfois les
héros vers leur destin, comme il conduisait les âmes des défunts dans
les anciennes religions. Et le décor nous ramène à Barenton, avec les
arbres, le ruisseau, le perron de Merlin.
Le chapitret
Il faut voir aussi les quelques mots peints dans le chapitret, « la
porte est en dedans ». Invitation à aller au-delà du visible, à entamer
sa propre Quête.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire