Fête de l'expectation
de l'enfantement de la Sainte Vierge
18 décembre

Cette
Fête, qui se célèbre aujourd'hui, non seulement dans toute l'Espagne,
mais dans presque toutes les Églises du monde catholique, doit son
origine aux Évêques du dixième Concile de Tolède, en 656.
Ces
Prélats ayant trouvé quelque inconvénient à l'antique usage de célébrer
la fête de l'Annonciation de la Sainte Vierge au vingt-cinq Mars,
attendu que cette solennité joyeuse se rencontre assez souvent au temps
où l'Église est préoccupée des douleurs de la Passion, et qu'il est même
nécessaire quelquefois de la transférer dans le Temps Pascal, où elle
semble présenter une contradiction d'un autre genre, ils décrétèrent que
désormais on célébrerait dans l'Église d'Espagne, huit jours avant
Noël, une fête solennelle avec Octave, en mémoire de l'Annonciation, et
pour servir de préparation à la grande solennité de la Nativité.
Dans
la suite, l'Église d'Espagne sentit le besoin de revenir à la pratique
de l'Église romaine, et de toutes celles du monde entier, qui
solennisent le vingt-cinq Mars comme le jour à jamais sacré de
l'Annonciation de la Sainte Vierge et de l'Incarnation du Fils de Dieu ;
mais telle avait été durant plusieurs siècles la dévotion des peuples
pour la Fête du dix-huit Décembre, qu'on jugea nécessaire d'en retenir
un vestige.
On
cessa donc de célébrer en ce jour l'Annonciation de Marie ; mais on
appliqua la piété des fidèles à considérer cette divine Mère dans les
jours qui précèdent immédiatement son merveilleux enfantement.
Une nouvelle Fête fut donc créée sous le titre de l’Expectation de l’Enfantement de la Sainte Vierge.
Cette
Fête, qui est appelée Notre-Dame de l'O, ou la Fête de l’O, à cause des
grandes Antiennes qu'on chante en ces jours, et surtout de celle qui
commence O Virgo Virginum ! (qu'on a retenue à Vêpres dans l'Office de
l’Expectation, sans toutefois omettre celle du jour, O Adonaï !) est
toujours célébrée en Espagne avec une grande dévotion. Pendant les huit
jours qu'elle dure, on célèbre une Messe solennelle de grand matin, à
laquelle toutes les femmes enceintes, de quelque rang qu'elles soient,
se font un devoir d'assister, afin d'honorer Marie dans sa divine
grossesse, et de solliciter pour elles-mêmes son secours.
Il
n'est pas étonnant qu'une dévotion si touchante se soit répandue, avec
l'approbation du Siège Apostolique, dans la plupart des autres Provinces
de la catholicité ; mais antérieurement aux concessions qui ont été
faites sur cette matière, l'Église de Milan célébrait déjà, au sixième
et dernier Dimanche de l'Avent, l'Office de l’Annonciation de la Sainte
Vierge, et donnait à la dernière Semaine de ce saint temps le nom de
Hebdomada de Exceptato, par corruption de Expectato.
Mais
ces détails appartiennent à l'archéologie liturgique proprement dite,
et sortiraient du genre de cet ouvrage ; nous revenons donc à la fête de
l'Expectation de la Sainte Vierge, que l'Église a établie et
sanctionnée, comme un moyen de plus de raviver l'attention des fidèles
dans ces derniers jours de l'Avent.
Il
est bien juste, en effet, ô Vierge-Mère, que nous nous unissions à
l'ardent désir que vous avez de voir de vos yeux Celui que votre chaste
sein renferme depuis près de neuf mois, de connaître les traits de ce
Fils du Père céleste, qui est aussi le vôtre, de voir enfin s'opérer
l'heureuse Naissance qui va donner Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et sur la terre Paix aux hommes de bonne volonté. O Marie ! les heures
sont comptées, et elles s'écoulent vite, quoique trop lentement encore
pour vos désirs et les nôtres. Rendez nos cœurs plus attentifs ; achevez
de les purifier par vos maternels suffrages, afin que si rien ne peut
arrêter, à l'instant solennel, la course de l'Emmanuel sortant de votre
sein virginal, rien aussi ne retarde son entrée dans nos cœurs, préparés
par une fidèle attente.
Source :
La
fête de l'Expectation ou de l'Attente indique, par son nom seul, son
origine et son objet ; aussi suffit-il d'en rappeler les traits
principaux.
Sans
nul doute, Joseph et Marie, dans leur modeste habitation de Nazareth,
partageaient toutes leurs journées entre la prière et le travail. Ils
étaient d'ailleurs inséparables, car l'Évangile ne fait mention que d'un
court voyage de Marie, celui où elle alla vers les montagnes, en la
ville de Juda, voir sa cousine Élisabeth, et où elle s'entendit appeler
des doux noms de Bienheureuse et Bénie entre toutes les femmes. Ce fut
dans cette touchante visite que, suivant les expressions d'un saint Père
: « Élisabeth, la « première, écouta la voix, mais Jean, le premier,
sentit « la grâce ; elle aperçut l'arrivée de Marie, et il pressentit «
l'avènement de Jésus. » Alors fut entonné l'immortel cantique du
Magnificat. Trois mois après, la chaste épouse rentra sous le toit
conjugal pour y reprendre ses travaux accoutumés auprès de Joseph. Dieu
ne tarda pas à en.voyer à cet homme juste un ange qui lui révéla le
mystère de la sainte Maternité, en lui disant : «Joseph, fils de David,
ne craignez pas de prendre avec vous Marie, votre épouse ; car ce qui
est né eu elle est du Saint Esprit. » Le Patriarche ému, comprit
l'immensité de l'honneur qui lui était fait, et combien il devait
s'estimer heureux d'être appelé à tenir lieu de père sur la terre au
Fils de Dieu, au Fils d'une Vierge ; et dès ce moment, Marie et Joseph
furent dans l'attente de l'enfantement prédit par Isaïe, jusqu'au jour
où le Messie, fils de David, dut quitter Nazareth pour naître, selon les
prophéties, dans Bethléem, humble patrie de David. C'est la mémoire de
cette expectation, où la figure de la sainte Vierge apparaît environnée
d'une triple auréole de pudeur, d'inspiration et de joie, que l'Église a
voulu consacrer particulièrement.
Quelques
auteurs, et notamment Bergier, n'ont fait qu'une seule solennité de
cette fête et de celle de l'Annonciation ; mais ce sont deux solennités
distinctes.
Il est vrai qu'à Tolède et dans plusieurs autres lieux de l'Espagne, on
célèbre, le 18 décembre, à la place de l'Annonciation, la fête de
l'Attente des couches de Marie. On y honore alors pendant huit jours la
sainte Vierge par une Messe à laquelle assistent surtout les femmes
enceintes.
En Italie, on célèbre, à la même époque, une Messe de l'Expectation de l'Enfantement.
En
France, cette fête est aujourd'hui du nombre de celles dont le
Souverain Pontife a favorisé la restauration, et que les âmes pieuses ne
manquent pas d'observer.
En savoir plus : Livre "Exercices de piété pour tous les jours de l'année. Décembre" par Jean Croiset page 325
Grandes antiennes « Ô » de l'Avent

La Visitation, Monastère de Strahov.
Les Grandes Antiennes encadrent le cantique du Magnificat ou cantique de Marie lors de la Visitation
Les
grandes antiennes « Ô », en latin « antiphonae majores », ou encore
« Grandes Ô », Ô de devant Noël, Ô de Noël, sont des chants bibliques,
chantés par les fidèles et les communautés monastiques, aux vêpres de
l'Avent dans la semaine précédant la Nativité c'est-à-dire Noël, depuis
le VIIIe siècle environ.
Venant
du grec grec ancien : ἀντίφωνον, le mot « antienne » signifie chant
alternatif, à savoir, alternance entre deux groupes de chanteurs.

La
fête de l'Attente durant l'Avent, ou fête de l'Espérance ,ou encore
fêtes des Ô de l'Avent, était anciennement la fête de l'Annonciation, au
premier jour des antiennes
L'Avent
est composé de quatre dimanches, et ces antiennes sont étroitement
liées à une fête qui suivait le troisième dimanche de l'Avent ou
« dimanche de la Joie », dit en latin « Gaudete », fête qui est aussi la
« Fête de l'Attente », en latin « expectatio », ou encore « Fête de
l'Espérance » : - fête de « Sainte-Marie de l'Ô » ou « fête de l'Ô ».
Elles
sont appelées aussi Antiennes de Magnificat, en latin « antiphonae
super magnificat », parce qu'elles sont chantées avant et après le Magnificat, le Benedictus ou après le Rorate.
L'origine
des huit grandes antiennes « Ô » se trouve dans le rite romain auprès
du Saint-Siège, plus précisément le sacramentaire. D'où, d'une part, la
schola cantorum conservait sa pratique à la basilique Saint-Pierre, avec
le chant vieux-romain, chant papal officiel. D'autre part, ces
antiennes furent importées dans le royaume carolingien au VIIIe siècle,
une fois que cette dynastie avait adopté le rite romain. Amalaire de
Metz devint leur premier commentateur. La version en grégorien demeure
en usage jusqu'ici. En Espagne, la fête de l'Ô ou de l' Expectatio de la
Vierge, est antérieure, puisqu'elle remonte à la conversion d'un roi
wisigoth au VIe siècle : cependant aucun manuscrit de la liturgie
mozarabe ne porte la trace des antiennes Ô. Les religieux trinitaires en
répandirent le culte en Espagne et en Amérique du Sud où de nombreuses
églises portent le nom de Ô.
Les
antiennes, leur contenu (entre deux antiennes semblables), les dates
auxquelles on les chantait, leur nombre, (généralement, de sept à neuf,
mais jusque dix-huit) différaient selon les lieux depuis les premiers
temps où elles furent chantées, puisque Amalaire de Metz remarque déjà
les divergences entre Metz et Rome.
Ces
antiennes, affirme Dom Prosper Guéranger, qui reste leur plus grand
commentateur dans son « Avent Liturgique », « contiennent toute la
moëlle de la liturgie de l’Avent », reprenant le titre humoristique,
d'un célèbre ouvrage ancien sur « la moëlle et sauce friande des saints
savoureux Os de l'avent ».
Elles sont très populaires dans l' Eglise anglicane, et furent répandues ainsi aux Etats-Unis en Amérique du Nord.
Textes et distribution traditionnelle
Articles détaillés : Tableau des antiennes Ô de l'Avent et Symbolique des antiennes Ô.
| Antienne | Distribution A (tradition principale) | Distribution B (variante) |
|---|---|---|
| O Sapientia | 17 décembre | 16 décembre |
| O Adonaï | 18 décembre | 17 décembre |
| O Radix lesse | 19 décembre | 18 décembre |
| O Clavis David | 20 décembre | 19 décembre |
| O Oriens | 21 décembre | 20 décembre |
| O Rex gentium | 22 décembre | 21 décembre |
| O Emmanuel | 23 décembre | 22 décembre |
| O Virgo Virginum | — | 23 décembre |
Histoire des antiennes
Les
antiennes dites « Grandes Ô », « Grandes Antiennes », ou encore jadis,
« OO de l'Avent » « OO de Noël », communément « Neuvaine des Ô de Noël »
, sont avant tout le rappel de l'attente du Messie par Israël durant
4000 ans (chiffre symbolique) par les Patriarches, et par les Prophètes.
Ces antiennes dateraient du pape Grégoire le Grand
(600). Quatre de ces invocations majeures (comme Emmanuel, Sapientia,
Radix) et deux mineures (judex, lapis) se trouvent dans la très ancienne
liste Carmen de cognomentis Salvationis, du Pape Damase Ier
(IVe siècle). On pense que Boethius ferait une légère allusion à
l'antienne « O Sapientia » dans le De consolatione Philosophiae au
VIe siècle. Le V° concile de Tolède en 636, ayant institué la fête de
l'Attente, ordonne de chanter chaque jour une de ces antiennes pendant
l'octave de l'Annonciation, qui était alors célébrée huit jours avant
Noël et on en trouve trace dans la liturgie de l’avent à partir du
VIIe siècle.Ces invocations dateraient donc du VIIe ‑ VIIIe siècle à
Rome, et furent répandues sous le Pape Eugène Ier. De type romaines et
non grégoriennes en leur origine, puis auraient été introduites à Milan
(chant ambrosien) après le VIIIe siècle et auraient été plus tard, en
Gaule rectifiées pour s'accorder aux canons du chant grégorien. Elles
auraient été mises en forme par les moines de l' Abbaye de
Saint-Benoît-sur-Loire au VIIIe siècle. Vers l’an 830 Amalaire de Metz
leur consacre un chapitre dans son ouvrage De Ordine Antiphonarii
(chapitre 13). Selon le pasteur Ludger M. Reichert, ces antiennes sont
des chefs-d'œuvre de l'art chrétien de l'Antiquité tardive (VIe/VIIe siècle).

Vierge de l'Avent,l'Enfant Jésus dans un ѽ oméga
Ces
antiennes pourraient être du type Ad praelegendum, qui existaient dans
la liturgie wisigothique, c'est-à-dire, prophétiques ou proclamatoires,
dont parle saint Germain dans une de ses lettres, donc d'un type très
ancien : on n'en n’est pas certain, puisqu'elles se disent durant les
vêpres et non durant la messe, sinon qu'elles sont effectivement, le
rappel de l’attente des patriarches et des prophètes, avec « ardeur,
sanglots et soupirs » à la « lueur sombre des vêpres », Orient et Soleil
de Justice, attente de l'aurore du jour de Noël qui convertira la
tristesse en joie. Elles apparaissent plus tardivement de manière
certaine, dans les antiphonaires, vers le VIIIe siècle, la fête de
l'Attente datant elle, du VIe siècle.
Articles détaillés : Antienne et Antiphonae ad praelegendum.
Elles pourraient aussi reprendre l’enseignement de Tertullien auteur d'un ouvrage intitulé l'Espérance des fidèles.
Article détaillé : Symbolique des antiennes Ô.
Pourquoi « Ô » ?
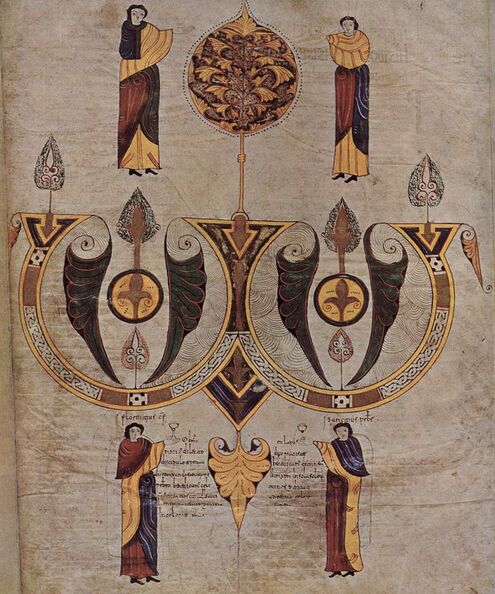
Bible de León de 960
On
les appelle ainsi car elles commencent par « Ô ». On les nomme
familièrement « Grandes Ô », « Antiennes Ô » ou encore « Ô, de Noël ».
Elles s'adressent au Christ biblique qui va naître, et comme toutes les
antiennes anciennes, contiennent de nombreuses références bibliques et
allusions au Nouveau et à l'Ancien Testament. À partir du Haut Moyen Âge
en chant grégorien monodique, elles sont toutes dans le même mode, le
deuxième mode. « Attente de Dieu », elles se terminent le 23 décembre,
veille de la fête de Noël célébrant la naissance de Jésus-Christ pour
tous les chrétiens.

Croix wisigothe de la Victoire, avec en pendentif un alpha majuscule (A) et un oméga minuscule (ω).
Un Oméga
Pour
quoi antiennes « Ô » ? d’après Reiner de Saint-Laurent de Liège
(Reinerus S. Laurentii Leodiensis) auteur qui, au XIIe siècle, écrivit
leur commentaire, elles sont nommées ainsi parce que dans la semaine de
huit jours (octave, de octo, huit) précédant Noël, elles tirent leur nom
du fait que si la lettre grecque alpha α signifie 1, l'omega ω (O
latin; Ѻ cyrillique) signifie 800. Le « Christ » est à la fois l’alpha,
le début, « le Créateur », le « Verbe » : et la fin, l’oméga,
c’est-à-dire le « Sauveur », le fils de Marie et le fils du dieu
"unique" (Dieu le Fils), lorsqu’il vient s’incarner (on pensait alors la
fin du monde toute proche donc l'oméga, au temps de Saint Paul). Le
chiffre huit serait (d'après Reiner) celui des huit béatitudes.

Initale O des Antiennes de l'avent, Maître du Méliacin, Antiphonaire dominicain, Ordre des Prêcheurs. fol.49v.
L'expression « OO » ou le « Ô » accentué n'est que l'expression de la lettre oméga (ω = oo) et qui est un O long.
C'est le roi franc Chilpéric Ier qui rajouta en France au VIe siècle à l'alphabet la lettre Ω selon Aimoin ou O selon Grégoire de Tours.
C'est le roi franc Chilpéric Ier qui rajouta en France au VIe siècle à l'alphabet la lettre Ω selon Aimoin ou O selon Grégoire de Tours.
Voir aussi le paragraphe : L'an 800, lettre oméga .
Un vocatif
Le
« Ω » grec est le vocatif « Ô », forme de l'interpellation, de la
supplication et de la prière mais en grec ancien et moderne c'est le
« O », marquant étonnement, admiration, douleur. Ce vocatif ὦ était très
employé dans l'antiquité, avant la naissance du Christ, comme on le
voit dans les tragédies grecques. Ici elles soulignent un peu, la
condition tragique de l’humanité enfermée dans le péché, avant la
naissance du Christ, mais c'est aussi et surtout la manière habituelle
ou solennelle, d'appeler et d'interpeller Dieu.
Un chemin, de la tristesse à la joie
Le
ton du Rorate (elles étaient aussi chantées avant et après le Rorate)
est également sombre, et les ornements liturgiques sont le violet durant
l'Avent, pour un temps de carême, de pénitence, avant Noël, de
méditation des triste et tragiques conséquences et châtiment du péché en
particulier, dans l’ancien testament, avec le cri de saint
Jean-Baptiste au désert « Repentez-vous » …sauf le dimanche Gaudete aux
couleurs roses, correspondant parfaitement, à l’exultation du
Magnificat. Bref, l'Avent oscille entre joie et tristesse. C'est le
temps de la métanoia, du retournement du cœur.
« Cieux,
répandez votre justice, que des nuées descende le Salut !Ne T’irrite
pas, Seigneur, ne garde pas le souvenir de nos péchés. ! Voici que ta
Cité sainte, Sion, a été dévastée : Jérusalem, Jérusalem, le séjour de
ta Sainteté et de ta Gloire, là où nos Pères ont chanté tes louanges.
Nous avons péché, et nous sommes devenus semblables aux païens, nous
sommes tombés comme des feuilles mortes, et nos péchés nous ont emportés
loin de Toi. Tu nous as caché ton Visage, et Tu nous as brisés à cause
de nos péchés.Regarde, Seigneur, l’abattement de ton Peuple, et envoie
Celui qui doit venir ! Envoie l’Agneau souverain de l’Univers, du Rocher
du désert jusqu’à la montagne de la Fille de Sion, et qu’Il nous
délivre du joug de nos péchés ! - Console-toi, console-toi, ô mon
Peuple, car bientôt viendra ton Sauveur et ton Roi ! Pourquoi te
laisses-tu consumer par la tristesse ? Parce que ta douleur t’a repris ?
Je te sauverai, ne crains pas ! Car je suis ton Sauveur, ton Seigneur
et ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Berger et ton Rédempteur »


o
rond cerclé d'anges dans lequel apparaît le Père céleste, qui a exaucé
la prière et envoyé son Fils sauver les hommes : « Gloire à Dieu au plus
haut des Cieux, paix sur la terre »
Cependant
au troisième dimanche de l'Avent, Gaudete, les ornements liturgiques du
prêtre, devenaient roses, les antiennes chantées communément et
partout, avant le Magnificat d'où leur nom, plutôt que le Rorate, la
Joie devait éclater, et se manifester durant toutes les antiennes de
l'Exultation du Magnificat aussi Reiner de Saint-Laurent insiste sur
cette joie éclatante de la naissance du Sauveur, vrai homme et vrai
Dieu, avant même Noël, au début et en conclusion de son commentaire de
la neuvaine des neuf antiennes Ô, et même hilarité ( ce qui signifiait
alors, allégresse, douce joie), gaudia, jucunditas, laetitia, hilaritas ,
quatre termes utilisés par Reiner, pour évoquer la joie des antiennes
Ô, concert musical suivi d'une collation, avant Noël, la joie des joies.
Le récit selon lequel Alcuin mourant, répétait sans cesse l’antienne Ô
Clavis David, avec le Magnificat dans sa cellule de l'abbaye Saint
Martin de Tours d'une voix « pleine d'allégresse » confirme que ce
moment des antiennes était celui de la joie.« Veillez donc, priant en
tout temps. » Que vous êtes bon, mon Dieu, et de nous amener à votre
amour par la crainte, en nous montrant des visions si terribles, et de
nous amener à votre amour par l'espérance, en nous prédisant des
bonheurs si célestes, et de nous amener à votre amour en nous donnant de
si nombreux conseils sur la manière de vivre en union avec
vous.(Charles de Foucauld)
Elles sont ainsi à relier à la très ancienne prière vespérale du Lucernaire , « Joie et Lumière » dont l’antienne Ô Oriens reprend l'essentiel : Φώς ιλαρόν αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, « Joyeuse lumière, splendeur éternelle de la gloire du Père », devenant « Ô Oriens splendor (variante: candor) lucis aeternae, et sol justitiae », O Oriens splendeur de la lumière éternelle et soleil de justice. Les anges resplendissent dans cette grande lumière lorsqu'ils apparaissent aux bergers leur annoncer une plus grande lumière encore, qui brille dans la grotte de la Nativité. L'habitude de dire des antiennes avec les psaumes est aussi ancienne que l’église et Egérie au cours de son pèlerinage en Terre Sainte, mentionne à de très nombreuses reprisses la joie de la prière du Lucernaire, c'est-à-dire des vêpres, faite d'hymnes, de psaumes et d'antiennes, à Bethleem comme à Jérusalem, à la lueur des cierges. On peut imaginer que les fêtes de la Nativité en comprenaient autant que les fêtes pascales.
Une lettre Ω … comme l'attente d'un enfantement
Cette
interjection annonce le Mystère de Noël étant la première lettre du mot
grec « Ωδις » signifiant « l'enfantement, les douleurs de l’enfantement
et son fruit, l’enfant. » (Luc, 2, Apocalypse, 12.). « Elle était
enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement »
(apôtre Jean, Apocalypse, 12:2.). C'est la fête de l'attente de cet
enfantement.
Un Ω désidératif

Initiale
O. Les antiennes sont la prière des prophètes et traduisent leur ardent
désir de la venue du Sauveur Jésus, montant vers le Ciel
Ce « Ô » est aussi, une interjection « désidérative » marquant le désir,
il exprime le désir ardent, l'attente, l'espérance. Pour les anciens,
l'invocation, la prière surtout : « l'Appel ». Cet adverbe désidératif,
exprime selon le moine Radulphus, « la longue attente, le désir ardent,
la soif que les Pères anciens et les douze prophètes ont eu du Messie
qui viendrait sauver Israël et toute l'humanité ».
« Les
justes venus au monde au début, comme Abel et Noé, ont été, pour ainsi
dire, appelés à la première heure, et ils obtiendront le bonheur de la
résurrection en même temps que nous. D'autres justes venus après eux,
Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui vivaient à leur époque, ont été
appelés à la troisième heure, et ils obtiendront le bonheur de la
résurrection en même temps que nous. Il en ira de même pour ces autres
justes Moïse, Aaron et tous ceux qui ont été appelés avec eux à la
sixième heure ; puis les suivants, les saints prophètes, appelés à la
neuvième heure, goûteront le même bonheur que nous. À la fin du monde,
les chrétiens, qui sont comme appelés à la onzième heure, recevront avec
eux le bonheur de la résurrection. Tous le recevront ensemble. Voyez
pourtant combien de temps les premiers attendront avant d'y parvenir.
Ainsi ils obtiendront ce bonheur après une longue période, et nous, après peu de temps. »
— Saint Bernard (de Clairvaux), Sermon 87,1.4-6
.
L'oméga symbolise après des millénaire d'attente, l'incarnation du Verbe et les deux avènements du Seigneur : Sa naissance, sa venue, et son retour (la parousie) c'est-à-dire le premier et le second avènement, et successivement : l'attente des patriarches, celle des prophètes, l’attente des justes, l’attente des chrétiens.
Un Oh d’émerveillement

Dans les antiphonaires, le Ω est devenu O.
Marie enceinte, porte en elle le Soleil de Justice. Vêtue de rose,
couleur qui représente la joie, l'antienne Ô Oriens (Aurore, Soleil
levant) , le dimanche Gaudete :Quelle « est celle-ci qui s'avance comme
l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme
une armée rangée en bataille? » (Cantique 6:10) elle tient à la main,
les saintes écritures
Les
antiennes anglaises utilisent parfois la forme « Oh » comme vocatif,
quoique la forme O soit préférée. Ce O vocatif, et désidératif, exprime
aussi par extension de sens poétique, l'étonnement, l'admiration,
l'émerveillement devant la grossesse de Marie, (rendue fécondée par le
Saint-Esprit selon la foi chrétienne) et « Mère du Verbe incarné » qui
fait le « petit enfant faible et innocent »… : Selon Jacques Viret par
exemple, ce « O » de forme ronde, ce cercle évoque le soleil et le
solstice d'hiver de Noël.Sous le soleil il a reçu sa forme et du soleil,
dans le ventre de sa mère il a reçu la forme : la lettre O
comme l' oméga ressemble à merveille à la rondeur du ventre d'une femme
enceinte du Fils de Dieu, le Très-Haut, le Saint des saints, et prête à
...perdre les eaux le soir de Noël. L'oméga évoque le nom symbolique de
Jésus dans l'Apocalypse : Je suis le premier et le dernier, le Vivant. « Ayant
formé le soleil, sous le soleil Il a reçu sa forme. Ayant ordonné
l'ensemble des siècles depuis le sein du Père, depuis le vente de sa
mère, Il rend ce jour-ci sacré. En Lui il demeure, d'elle Il naît.
Créateur du ciel et de la terre, Il naît sur la terre et sous le ciel.
Sage au-delà de toute parole, sage avant de pouvoir parler. Il couvre le
monde, Lui que contient une crèche. Il règle le cours des astres, cet
enfant à la mamelle. Grand comme Dieu, petit comme serviteur, sans que
sa Petitesse diminue sa Grandeur, et sans que sa grandeur accable sa
Petitesse. Car en revêtant un corps humain, Il n'a pas cessé de faire
œuvre divine ; et ne s'est pas relâché de l'étroit embrassement par
lequel Il soutient l'univers d'une extrémité à l'autre, et le dispose
harmonieusement : quand Il S'est revêtu de l'infirmité de la chair, le
sein d'une Vierge l'a recueilli, sans L'emprisonner; et sans rien
soustraire au pain dont il nourrit la sagesse des anges, Il nous a donné
à goûter combien doux est le Seigneur .» (saint Augustin)
Les
antiphonaires ne représentaient jamais la lettre omega ou double OO
original, mais toujours la lettre O latine, la plupart du temps en rouge
ou bleu mais parfois en d'autres couleurs, enluminant l'antiphonaire
d'un grand « O » turquoise, par exemple.
Une lettre mystérieuse

thumb
Alpha
et Oméga évoquent le livre de l’Apocalypse, dont le nom est devenu
synonyme de fin des temps, alors qu'il signifie « révélation » (de ce
qui était caché ) : « Je suis le premier et le dernier », « le Vivant »
( le chiffre dix-huit, symbole ésotérique du chiffre des lettres du
verbe hébreu chaya, signifiant vivre, vivant, la vie chez les juifs, haï
mais aussi tout simplement l'alpha, le Créateur de la Vie (Genèse), et
l’oméga, le Christ ressuscité, le Vivant, ( des Evangiles) c'est-à-dire
le Verbe incarné) le premier avénement (=adventum) du Christ mais aussi
le dernier comme le souligne Jacques de Voragine et d'autres auteurs, le
début et la fin des temps, la création et la parousie, le jugement
dernier. ( cf. symbolique des antiennes Ô). Entre tous ces symbolismes,
le cri d'appel de l'homme vers Dieu est cependant le plus grand et le
seul évident puisque grammaticalement il s'agit bien d'un vocatif, et
rien d'autre que cela : mais à l'époque du Moyen-Age , on aimait
beaucoup gloser et trouver des sens secrets et cachés, interpréter les
mots : Avent, adventum, alpha, mais aussi oméga, arrivée du Christ, mais
aussi retour du Christ: « Maranatha » crie saint Paul dans l'attente de
ce retour : viens, Seigneur Jésus. Ce cri n’existe d'ailleurs pas en
hébreu, on ne le trouve qu'en araméen, dans les épîtres de Paul.Ce Veni
deviendra avec le cri 'Noël" l'invocation de la naissance du Christ :
Veni, Redemptor gentium; Ostende partum virginis, Miretur omne saeculum,
.Talis decet partus Deo. (saint Ambroise) jusqu'aux Noëls
contemporains : Venez, Divin Messie !
Il
semble exister une autre possibilité, en raison de plusieurs mots
latins importants tel « Omnes ». Selon une mentalité médiévale, la
lettre « O » aurait été assez mystérieuse. Ainsi, un labyrinthe « O » se
trouve dans le manuscrit du chant grégorien Graduale Albiense auprès de
la Bibliothèque nationale de France (XIe siècle) [lire en ligne]. Le Ω devenant O dans les antiphonaires, le son reste le même.

La Nativité (Musée Benaki d'art et d'histoire à Athènes)
Une lettre issue de la liturgie grecque
Si
l'origine est assez ancienne, il est possible que cette pratique soit
issue de la langue grecque comme le trisagion. Rappelons que, pendant
les premiers trois siècles, la célébration de l'Église catholique fut
exécutée en grec. Si tous les textes furent remplacés en latin au
IVe siècle, dans le chant vieux-romain, chant officiel du Saint-Siège
jusqu'au début du XIIIe siècle, il restait quelques versets en grec.
Ceux-ci pourraient remontrer entre les Ier et IIIe siècles, même si les cinq manuscrits restants ne furent copiés qu'à partir de 1071 :
Alleluia.
O Kirioc keba kyleocen
euprepia enedisato .........
(Alléluia.
Le Seigneur règne maintenant,
il est revêtu de majesté, .........)
O Kirioc keba kyleocen
euprepia enedisato .........
(Alléluia.
Le Seigneur règne maintenant,
il est revêtu de majesté, .........)
Ce
verset était très important, car il s'agissait de celui des vêpres de
Pâques, fête la plus distinguée de l'Église. Celui-ci était encore
chanté lors de la messe du lundi de Pâques, juste avant la lecture de
l'Évangile.
Article détaillé : Chant vieux-romain § Caractéristique du chant vieux-romain.
La
canon de Pâques de saint Jean Damascène comprenait par exemple cette
invocation « Ὤ Πάσχα τό μέγα ἱερώτατον, Χριστέ, ὤ Σοφία καί Λόγε τοῦ
Θεοῦ καί Δύναμις ». « Ô Christ, […] Ô Sagesse, Verbe et Puissance de
Dieu ». C'est pour cette raison que les anciens auteurs comme Reiner ont
insisté sur l’origine grecque du « Ô » comme étant un Oméga.

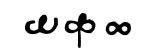
La
Lettre oméga, symbole du désir, de l'appel, de l'attente du Dieu et
tournée vers le haut, vers Dieu resté dans le Ciel, qui échappe aux
hommes et reste un mystère. Attente des hébreux, attente de toute
l'humanité d'un Sauveur: un cri, un appel vers le Ciel.


Le
Sacré-Cœur de Marguerite Marie Alacoque, a la forme d'un oméga
renversé. L'incarnation du Verbe devient la charité, inaugure le règne
de l'Amour, symbolisé par un cœur de chair, de l'émotivité de
Jésus-Christ, de sa charité du Dieu vivant : « et le Verbe s'est fait
chair, et il a habité parmi nous ».

« Et
ce jour-là, on dira : « Voici notre Dieu, en lui nous espérions, et il
nous a sauvés ; c’est lui le Seigneur, en lui nous espérions ; exultons,
réjouissons-nous : il nous a sauvés ! » (Livre d'Isaïe 25)
Aurore et crépuscule
Ainsi
se termine le cantique Magnificat ou « Cantique de Marie » et on les
appelle donc aussi « Antiennes du Magnificat » car chantées avant et
après durant le Vêpres de l'Avent, à la tombée du soir, à l'heure de
l'encens, comme le Lucernaire :

La
Visitation, rencontre entre Marie enceinte et sa cousine Elisabeth. Les
antiennes (respons) forment le responsorial du cantique : un écho à la
prière de Marie, qui chante sa joie de la venue du Sauveur attendu
durant des siècles : Seigneur Adonaï, Oriens, soleil de Justice. Racine
de Jéssé, et descendant de Salomon et David, Roi et maître de Justice,
Emmanuel, Dieu avec nous.
«Mon âme exalte le Seigneur,
Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
Désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
Il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël , son serviteur, Il se souvient de son amour,
De la promesse faite à nos pères, En faveur d' Abraham et de sa race à jamais.
- Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen. »
On
les chantait aussi en un usage plus ancien, à Laudes avant et après le
Benedictus, ou « Cantique de Zacharie », et même entre chaque versets du
Benedictus que les antiennes Ô Clavis David et Ô Oriens illustraient
tout particulièrement, à l’aurore, au lever du soleil. On répétait
ensuite de douze à quinze fois, le cri « Ô Noël ». Ce cri de « Ô Noël »
semble avoir accompagné aussi les antiennes « Ô » des vêpres, comme le
rapporte un ancien vespéral : « Un usage analogue existe de nos jours
encore dans le diocese de Reims, où l'acclamation Noël, six fois
répétée, sert de refrain à quatre reprises, à des versets tirés de
l'Écriture, à la fin de chaque office de l'Avent ».
« Béni
soit le Seigneur, le Dieu d'Israël qui visite et rachète son peuple. Il
a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son
serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses
prophètes, depuis les temps anciens :salut qui nous arrache à l'ennemi,à
la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte,serment juré à notre père Abraham,de nous
rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis nous le
servions, dans la justice et la sainteté en sa présence, tout au long de
nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du
Très-Haut : tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras
ses chemins pour donner à son peuple de connaître le salut par la
rémission de ses péchés grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu,
quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent
les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de
la paix ». 

alpha et oméga
Structure des antiennes
Forme tripartite
D'après l'abbé Bohler, le cycle des antiennes Ô est structuré par une « forme tripartite récurrente » :
«
Tout d’abord une partie commençant par le vocable « O » suivi du titre
christologique. Une deuxième partie va déployer, commenter le titre
conféré. Enfin la troisième partie est toujours un appel qui commence
par le verbe « veni » (viens).L’appel est systématiquement en lien avec
la deuxième partie. D’après les catégories d’analyse de l’édition
critique de l’antiphonaire par l’abbaye deSolesmes on peut se rendre
compte que la structure musicale est complètement calquée sur la
structure narrative. La mélodie de chaque antienne forme une «
période » que l’on peut nettement diviser en trois « incises ». Chaque
« incise » correspondant à chacune des trois parties narratives. Les
deux premières incises formant un « membre » de la période,
correspondant au « protasus ». La dernière incise formant le deuxième
« membre » correspondant à « l’apodosis ». Le « protasus » permet de
souligner la structure narrative de l’annonce du titre christologique et
de son déploiement littéraire. « L’apodosis » permettant alors de
souligner l’appel. La grammaire musicale épousant parfaitement la
grammaire littéraire, nous sommes en présence d’un chef-d’œuvre du
genre. »
— Abbé Emmanuel Bohler, Les titres christologiques dans les 7 antiennes "O" de l'avent.
L'acrostiche « ero cras »

L'initiale
du premier mot de ces sept antiennes de la dernière à la première donne
en inversé (« en miroir »), en latin l'acrostiche ERO CRAS :
« Demain je serai là » présent dans l'Office de la Nuit de Noël
eucharistique. En rajoutant l'antienne Ô Virgine Virginum, cela donne
aussi « vero cras ». Il s'agit bien entendu de Noël et du Dieu Eternel
entré dans le temps. Cet acrostiche « en miroir » correspond la liturgie
de Noël : « Demain » (cras) devient alors « Aujourd'hui » (hodie), car
le grand chant de Noël par excellence est alors la séquence grégorienne
tirée du prophète Isaïe, Hodie Puer Natus est, « aujourd'hui un enfant
nous est né... » ; on trouve également dans la liturgie du 24 décembre
de l'Office des laudes, l'antienne initiale : « Aujourd’hui le Seigneur
va venir, demain vous verrez sa gloire ».
Le
verbe « ero » est le futur latin du verbe esse, je suis : un de noms de
Dieu et le plus grand en hébreu : YHWH. L'étymologie indo-européenne du
mot « cras » k̂eu-* (« briller »), renvoie à celle de aurora (« aurore,
aube ») et uro (« brûler ») qui comporte la même métaphore du moment où
la lumière du jour commence à briller : c'est la messe de l’Aurore de
la nuit de Noël, mais aussi et surtout, l'avènement de la vraie lumière
après des siècles de ténèbres.
Une autre interprétation donne SARC ORE
c'est-à-dire sarx, « corps » en grec, ore, de os « bouche » en latin,
évoquant le « Verbe fait chair », c'est-à-dire bouche de chair, lèvres
humaines, parole humaine, voix humaine, la Parole de Dieu le Père sur
des lèvres humaines, car le Christ est la seule « Parole » du Père.
Soit, le corps de Jésus, né d'une Vierge, le nouveau Temple : « voix du
Seigneur dans la force, voix du Seigneur dans l’éclat (Ps.29:4 psaume
chanté à la fin de la fête des Tentes : « Dieu a habité parmi nous ».
) » :
«
Les sept emplois de l’expression « voix du Seigneur » (Ps.29), qui
revient comme un refrain, sont là pour nous indiquer que Dieu nous parle
de multiples façons. Il nous parle par sa Création, il nous parle
encore par sa Parole de Vie que nous trouvons dans la Bible, il parle
enfin en chacun de nous par une voix intérieure (cf. saint Augustin :
« Et, cette raison, c’est votre Verbe, le principe de tout, la voix
intérieure qui nous parle », Confessions, Livre XI, Ch. VIII, no 10 »
Soit
l'Eucharistie, nourriture, liée à l'Amour divin comme Nouvelle Alliance
succédant à l’ancienne. Les antiennes seraient donc une sorte de
préparation pour recevoir avec le cœur à Noël, l’Enfant Jésus, ses
pleurs et ses cris, dans la crèche, lui qui est le Cœur de Dieu et Dieu
fait chair : c'est le Mystère de Noël.
Avant Jésus-Christ
Une longue attente du Messie
« C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe: Voici la Vierge est enceinte et enfantera un fils, et elle l'appellera "Emmanuel". »
— Isaïe.

Icône orthodoxe de Koursk, Vierge de l'Avent, dite du Signe, ayant Jésus en elle, dans un O entourée des Douze Prophètes, comme douze antiennes, tenant les paroles de Écritures sur des phylactères
Les
antiennes « Ô » associent l'invocation du Messie, « Ô », avec la prière
pour sa venue (introduite par : « veni », « viens » et s'appuient sur
les textes de l'Ancien Testament (notamment sur le livre d'Isaïe, 7,
14). Chaque antienne reprend une prophétie d'Isaïe et d'autres livres de
l'« Écriture Sainte » (Saintes Écritures) de l'Ancien et Nouveau
Testament: (Judith, Malachie, Ezéchiel, Aggée, Zacharie, Actes…). Les
antiennes sont l'image de l’ardent désir, des prières et des soupirs des
patriarches et des prophètes dans l’attente de la venue du Sauveur, et
de leurs prières, qui ne pouvaient être exaucées avant le temps de sa
venue.

Notre-Dame de Paris, la Vierge au centre de la rosace et les prophètes forment cercle autour d'elle
Et
chacune est un titre du « Messie » dont la naissance était attendue en
Israël depuis environ le VIIIe siècle (siècle où vécut Amos) avant la
naissance de Jésus de Nazareth, « Jésus-Christ ».
« Le Messie, artisan d’un royaume de lumière, de cette lumière étincelante de l’Orient qui est le symbole de la vie heureuse et prospère, d’un royaume qui a le Seigneur pour auteur, est comme le point de convergence de toute l’histoire d’Israël. »
— P. Marie-Joseph Le Guillou.
.Et
l'attente religieuse de Marie, et celle dans la religion juive de la
« fille de Sion » et l'enfantement du « divin enfant » (Enfant Jésus),
se confondent pour les chrétiens, durant ces huit jours, et inscrivent
l'importance du rite de la semaine, avec son rituel musical. Selon la
liturgie chrétienne, Marie la mère de Jésus de Nazareth, avait été
accordée en mariage à Joseph.
« Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement ; il décida de la répudier en secret. Il avait formé ce projet, lorsque l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse : l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint ; elle mettra au monde un fils, auquel tu donneras le nom de Jésus (c'est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva selon la liturgie chrétienne, pour que s'accomplît la parole du Seigneur prononcée par le prophète : « Voici que la Vierge concevra et elle mettra au monde un fils, auquel on donnera le nom d'"Emmanuel" », qui se traduit : « Dieu-avec-nous ». » »
— « Livre d'Isaïe », 7:10-16; Évangile selon saint Matthieu, 1:18.
Son rituel musical annuel est une mise en harmonie du « Mystère » qui comporte les antiennes « Ô ».

Martin
Schongauer, Collégiale Saint-Martin de Colmar Dans le nimbe d’or de la
Vierge, un texte fait parler une rose : « Me carpes genito tu quoque o
Sanctissima Virgo » : « Tu iras, toi aussi, me cueillir (pour ton fils),
ô très Sainte Vierge » - Antienne de la Fête du Saint-Rosaire « Les
filles de Sion l'ont vue comme un rosier couvert de fleurs, et ils l'ont
proclamée bienheureuse. »
Un roi de paix
Les
deux antiennes Ô Sapientia et Ô Adonai semblent correspondre l'une à la
Grèce, avide de Sagesse, Sophia; et l'autre à Israël et cela rappelle
les nombreux passages (Galates 3:28 Ephésiens, Corinthiens 12:13
Colossiens 3:11) etc. des épîtres de saint Paul qui annoncent la
réconciliation des Juifs et des Grecs en un seul peuple comme le dit
l'antienne Ô rex gentium dans la paix, Rex pacifice, comme pierre
angulaire.
Un enracinement dans la tradition d'Israël

Bougies de l'Avent en Finlande
Au XIXe siècle, Mgr
Sarnelli citait ainsi quelques-unes des prières que les juifs avaient
coutume de réciter chaque jour et qui furent introduites lors du retour
de la captivité de Babylone. « Elles portent, comme nos antiennes de
Noël, le caractère de l'admiration plutôt que celui de l'aspiration, car
elles ont rapport aux principaux événements de l'histoire sainte. »
Elles formaient le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. On ne
peut pas compter les références des antiennes aux Psaumes, aux Livres
des Prophètes par : par exemple ici le psaume 2, pour O Rex gentium :
Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Je proclame le
décret du Seigneur ! + Il m'a dit : « Tu es mon fils ; moi, aujourd'hui,
je t'ai engendré. Demande, et je te donne en héritage les nations, pour
domaine la terre tout entière. ». Face au polythéisme enivré dans les
plaisirs, le monothéisme en Israël, est souvent, un cri dans la
souffrance, et la détresse, car il annonce un Messie et un Serviteur
souffrant : « Seigneur, au secours ! » « Délivres moi !».« Enseigne
moi ! » « libère-moi ! prends pitié de moi ! »
Cela constitue un enracinement dans la tradition d'Israël.
Les 18 bénédictions anciennes en Israël
Article détaillé : Amida (judaïsme).
« Ces prières portaient le nom de « bénédictions » : elles sont entonnées par quelqu'un de la synagogue, et tous les poursuivent, se tenant debout et avec les pieds joints et appuyés également sur le pavé. On dit aussi qu'ils le font dans une posture inclinée, parce que, selon leurs rabbins, l'épine dorsale, qui est formée de dix-huit ossements, doit être inclinée en récitant les dix-huit bénédictions… Que dire après cela de l'attention et de la piété que les chrétiens devaient mettre à réciter les prières que leur enseignait l'Église. »
— Mgr Sarnelli
Voici la liste :

Anne, Joachim et Marie
- O scutum Abrahœ, pour montrer la délivrance du saint patriarche de la ville d'Ur des Chaldéens.
- O vivificans mortuos, pour exprimer la délivrance d' Isaac, à la place duquel un bélier est immolé.
- Deus sanctus; elle a rapport à l'échelle du patriarche Jacob.
- O qui largiris scientiam : pour exprimer Joseph qui est éclairé de Dieu pour expliquer les choses secrètes et les songes.
- O qui paenitentiam amas, pour signifier Ruben lorsque, condamné à cause de son crime, il mérita d'être absous à cause de sa pénitence.
- O misericors qui multiplicas remissionem : on entend, par là, le pardon du crime commis par Juda et Thamar ; il fut pardonné à cause de l'aveu de Juda : justior me est.
- O Redemptor Israelis : cette prière a rapport à la rédemption de l'Égypte.
- O qui mederis infirmis : les juifs croient qu'Abraham fut malade de la circoncision, et ils récitent cette prière en actions de grâces de sa guérison.
- O qui benedicis annis, pour signifier qu'Isaac récolta cent pour un.
- O qui congregas dispersiones populi tui, pour exprimer la réunion de Jacob et de Joseph en Égypte.
- O rex qui diligis justiciam : elle a rapport aux paroles que Dieu dit à Moïse : Hac tunt judicia, etc.
- O qui conficis inimicos : c'est la submersion des Égyptiens dans la mer Rouge.
- O qui spem ac fiduciam das : c'est pour exprimer ce que Dieu a dit à Jacob : Joseph ponet manum suam super oculos tuos. 14. 0 qui œdificas Hierosolymam, par rapport à la construction de la ville de Sion par le roi David.
- O qui facis, ut germinet cornu Messiœ tui : c'est le passage de la mer Rouge.
- O qui audis orationem, pour rappeler que les Israélites prièrent Dieu et en furent exaucés.
- Qui restituit divinam majestatem tuam, lorsque la majesté de Dieu se fit voir dans le Tabernacle.
- Bonum est nomen tuum, lorsque Salomon introduisit l'Arche dans l'intérieur du Sanctuaire.
Ces
dix-huit bénédictions étaient dites quotidiennement. D ans le judaïsme,
une berakha ou brakha (héb.: ברכה; pluriel ברכות, berakhot) est une
bénédiction, habituellement récitée à un moment spécifique, avant de
réaliser une prescription, qu'elle soit d'origine biblique ou
rabbinique, de consommer un mets, lors de retrouvailles avec un ami,
etc. La fonction des berakhot est de rappeler à l'homme la présence
continue de Dieu à ses côtés, de mesurer l'importance de Sa providence,
et de L'en remercier. Certaines de ces bénédictions commencent comme les
antiennes par la formule Baroukh ata Adonaï Elohenou, Melekh haolam, …
("Béni es-Tu, Adonaï notre Dieu, Roi du monde, …").
Les
antiennes permettaient aux catholiques de prier pour la conversion des
Juifs, le nombre de références bibliques et de termes hébreux (Adonaï,
Emmanuel) « y incitait ». Les antiennes soulignent que Jésus est bien le
Fils de Dieu, et du Dieu Père de l'Ancien Testament. La coutume
d'allumer des bougies, une par jour, de faire des cadeaux, rappelle la
fête d'Hanouka ou de la dédicace, qui se célèbre en hiver aux alentours
de Noël. Le chiffre dix-huit est très présent dans la Bible. Il
symbolise la Vie ( haï) chez les hébreux.
Le calendrier lunaire de Qûmran

Selon
un ancien calendrier lunaire découvert à Qumran, un prêtre de la classe
d'Abiah, que l'on présume être saint Zacharie, aurait effectué durant
la pleine lune (le 17 septembre), son service au Temple dans la semaine
du 18 au 25 septembre : c'est alors que l'ange Gabriel lui aurait rendu
visite durant l'offrande de l’encens : sainte Elisabeth aurait alors
conçu saint Jean-Baptiste lequel serait né le 24 juin comme sa fête
liturgique le célèbre. Jésus-Christ serait né dix-huit mois plus tard au
mois de tishri. Les antiennes commencent dans la semaine du 17/18
décembre jusqu'au 25 décembre jour célébrant la Nativité. Elles étaient
jusqu'au nombre de 18 à Monza, mais le plus souvent de sept ou huit
antiennes, commençaient le 17 le plus souvent ; le 18 décembre était la
fête liturgique de l'Annonciation, devenue ensuite « fête de l'Attente »
(et reportée au 25 mars, six mois après la visite de l'ange à Zacharie,
prêtre de la classe d'Abiah, si l'on considère le calendrier lunaire de
Qumran) : les antiennes tombent en la période selon laquelle Marie doit
accoucher, dix-huit mois après la première visite de l'Ange Gabriel à
Zacharie et neuf mois après sa visite à Nazareth… durant cette période
Marie a rendu visite (Visitation) à Elisabeth afin de l'aider dans ses
tâches ménagères, et chanté le Magnificat. Selon Catherine Emmerich, la
famille de Marie et donc, du Christ, était essénienne.
Article détaillé : Noms de Dieu des antiennes Ô en hébreu.
Calendrier des Grandes antiennes « Ô » de l'Avent
Variété de calendrier

À la chapelle du Saint-Siège, ces grandes antiennes « Ô » en vieux-romain étaient quotidiennement chantées au Moyen Âge
Le
calendrier de l'exécution des grandes antiennes « Ô » demeurait
problématique, jusqu'à ce que le chant vieux-romain, ancien chant
officiel du Vatican, ait été identifié en 1950 par un musicologue
allemand Bruno Stäblein. Mais, il fallut encore beaucoup de temps, de
sorte que la coutume de celles-ci soit correctement reconnue. En
réalité, ces antiennes en vieux-romain étaient chantées non seulement
lors de l'Avent mais aussi toute l'année, à la basilique Saint-Pierre de
Rome, jusqu'au début du XIIIe siècle.
Découvert
aux Archivio di San Pietro en 1890, le manuscrit Vatican B79, l'un de
seuls cinq livres restants de ce chant, contient entièrement les grandes
antiennes « Ô ». Faute de propre notation, celui-ci fut copié au
XIIe siècle, en bénéficiant du système du chant grégorien. Dans le folio
14v, on écrivit : « Ces antiennes, à savoir O sapientia et celles qui
suivent, nous les chantons quotidiennement à Benedictus jusqu'à la fête
de sainte Lucie, sauf le dimanche. Nous les antiphonons à partir de In
sanctitate. » De surcroît, lorsque la célébration était solennelle,
« aujourd'hui, nous répondons à toutes les antiennes. »
Donc,
en raison de leur importance, l'exécution dans les offices était
quotidienne jusqu'au 13 décembre, fête de sainte Lucie, après laquelle
les antiennes étaient consacrées à l'Avent. Cela explique effectivement
les traditions très variées.
Ainsi,
l'Ordo du Chanoine Benoît (vers 1140) attestait l'usage de les chanter
du 6 au 13 décembre. Le théologien Jean Grancolas aussi affirmait que,
dans certains ordres romains, elles étaient chantées depuis le jour de
la saint Nicolas, donc le 6 décembre et duraient jusque Noël.

Nativité
Mais
surtout, il faut remarquer que l'on les chantait après la fête de
sainte Lucie, et celle de saint Nicaise, 13 et 14 décembre,
correspondant au calendrier du Saint-Siège.
Selon
Guillaume Durand et Honoré d'Autun, on en chantait durant douze jours
dans certaines églises pour honorer les douze prophètes qui ont annoncé
la venue du Messie et les douze apôtres qui l'ont prêchée qu'on peut
admirer sur les rosaces des cathédrales, ou l'icône russe de Notre-Dame
du Signe, tenant les paroles de leurs livres prophétiques en main. Pour
cette pratique, il semble que l'on dût avancer la première exécution.
Encore le nombre d'antiennes chantées différait-il selon les villes et les coutumes locales, et principalement :
- À Paris, Toulouse, dès le 15 décembre (2 antiennes supplémentaires, « O sancte sanctorum » ainsi qu' « O pastor Isræl »)
- À Rouen, Canterbury à partir du 16 décembre (8 grandes antiennes, y compris « O Virgo Virginum » en faveur du 23 décembre)
- À Rome, tardivement, dès le 17 décembre (7 grandes antiennes)
La
liturgie actuelle avec sept antiennes peut être expliquée, soit en
raison des chiffres saints (3, 7 et 12), soit par la différence de sujet
(Dieu et Sainte Vierge). Toutefois, les manuscrits grégoriens les plus
anciens conservaient toutes les huit. Étant donné que Sainte Marie était
la mère de Dieu et que le 23 décembre est la veille de la Nativité, la
pratique ancienne aussi avait raison.
L'ordre
dans lequel on chantait les antiennes pouvait également varier :
Amalaire de Metz constate les divergences entre l’antiphonaire de Metz
et l'usage romain
La « Table parisienne »

Une
table parisienne des Antiennes Ô, Solothurn, Zentralbibliothek, Cod. S
378 – Breviarium canonicorum regularium monasterii f. 176r. (cliquer
pour agrandir)
En
1263 apparaît la « table parisienne » (Tabula parisiensis, Rubrica
parisiensis ) des Antiennes de l’Office de Avent, afin de pouvoir
calculer grâce à sept tableaux ou plans, les différents jours de la
semaine où chanter les antiennes fériales de l’Avent et les antiennes Ô,
selon le jour de la semaine où tombait la fête de Noël. Toutes les
possibilités de dates et de jours de la semaine, étaient envisagées dans
ces sept tables : Si Noël tombe un dimanche, la première des antiennes
doit être chantées le vendredi de la troisième semaine de l'Avent, si
cela tombe un lundi, le jeudi de la seconde semaine, etc. Frère Rubinus,
sans doute franciscain et chantre parisien, aurait été l’artisan de la
plus célèbre de ces sept tables, en 1300, dans le domaine de la liturgie
conventuelle, et ces tables furent utilisées par tout l' ordre
franciscain, quarante ans après les premiers chapitres à Assise.
Le dimanche « Gaudete »
Articles détaillés : Traditions des antiennes Ô et Gaudete (tradition).

La couleur du dimanche Gaudete est le rose
On
écrivit en 1478 : « Le dimenche dernier des oleries de devant Noel, le
suppliant ala aux nopces a Joy le moustier. » Ce terme oleries
signifiait les antiennes « Ô ». Donc, on chanta au moins une antienne ce
dimanche de la joie, « Gaudete », dont la couleur liturgique est le
rose, était le troisième dimanche de l'Avent qui précédait les antiennes
et inaugurait la joie des agapes et celle plus spirituelle, de la
Nativité.
De nos jours, aucune antienne n'est chantée, normalement, en raison de nombre diminué.
« En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira ; vous serez affligés, mais votre affliction se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante, est dans la souffrance parce que son heure est venue ; mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses douleurs, dans la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. »
— Évangile de Saint Jean, 16:19-21
La « Fête de l'Attente » ou « Fête de l'Ô »
D'Espagne
elle entra dans le calendrier de toute l'église pour être fêtée le 18
décembre : Fête de l'Attente des couches de la Sainte Vierge Attente
millénaire de la venue du Messie par Israël, attente millénaire de toute
l'humanité du salut, attente de la naissance de l’enfant par sa mère
Marie durant neuf mois, et par Joseph, attente des enfants des siècles
futurs, de Noël, Attente de l’Église de la fête annuelle, se fondent en
une seule Attente en cette « fête de l'Espérance » et « fête de
l’Attente » des tous les hommes du Sauveur maître de la Vie :

O
Clavis David : Les Clefs de saint Pierre : « Et moi, je te dis que tu
es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les
portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te
donnerai les clefs du Royaume des cieux (...)». (Mat. 16)
« Frères bien-aimés, il y a une chose que vous ne devez pas oublier : pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. Le Seigneur n’est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines personnes ; c’est pour vous qu’il patiente car il n’accepte pas d’en laisser quelques-uns se perdre ; mais ils veut que tous aient le temps de se convertir … Dans l’attente de ce jour, frères bien-aimés, faites donc tout pour que le Seigneur vous trouve nets et irréprochables, dans la paix ». »
— saint Pierre, épîtres
« Un Avent est une attente et vous savez qu'il n'y a rien de plus dur que l'attente. Attendre, c'est toujours attendre dans l'espérance mais aussi dans l'incertitude. Une des tortures les plus profondes, c'est la torture de l'attente : toutes les polices du monde savent que l'attente est une des choses les plus tragiques et les plus douloureuses, à moins qu'elle ne soit habitée par l'amour. Demandons au Seigneur d'attendre dans l'amour, que ce temps de l'Avent soit une attente toute bénie du Seigneur, toute illuminée par le Seigneur.mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l’aurore. Ps 129 »
— Marie-Joseph Le Guillou , dominicain
Enfin le texte lui-même des antiennes pouvait varier d'un endroit à l'autre, mais pas l'invocation initiale, comme on peut le constater dans les Antiennes chantées à Sens.
Attente de la naissance de Jésus par la sainte Famille
Le Voyage de Marie et de Joseph en vue du recensement de Bethleem

Vers le Mont Guilboa

Nazareth viendrait de netzer, « fleur » en hébreu. couleur rose du dimanche gaudete

Bethleem signifie la « Maison du Pain »


Carte de Judée au première siècle
« En ces jours-là fut publié un édit de César Auguste, pour le recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius commandait la Syrie. Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville.Joseph monta de Galilée, de la ville de Nazareth, en Judée, à la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour être recensé avec Marie son épouse, qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient en ce lieu, le temps où elle devait enfanter s'accomplit. »
— Evangile de saint Luc, 2:1-6, traduction Augustin Crampon
Cette
période est également celle du trajet de Joseph et de Marie de Nazareth
(la maison de la flore) vers Bethleem (la maison du pain) tandis que
les rois mages suivent l'étoile qui les conduit vers la crèche et
l'enfant nouveau né et ressentent « une grande joie ».

Le
trajet entre Nazareth et Bethléem était d'environ 150 km. Depuis 1999
un itinéraire pédestre relie les deux villages, trajet qu'avec un âne ou
deux Joseph et Marie ont pu effectuer en cinq jours, sans compter les
haltes en chemin à la « belle étoile », sous un térébinthe, ou chez
l'habitant. Aucun récit historique ne nous en est parvenu. Les visions
de Catherine Emmerich dans sa Vie de Marie, offre un pittoresque récit,
[authentique ou imaginaire], de ce qu'aurait pu être ce voyage, à
travers plaines et montagnes, sans prendre la grande route : « Les
chemins de traverse qu'ils suivaient étaient très étroits ; dans la
montagne, ils étaient souvent si resserrés, qu'il fallait beaucoup de
précautions pour y avancer sans broncher. Mais les ânes y marchaient
d'un pas très assuré ». etc...une nuit à la belle étoile, quatre chez
des hôtes à l'auberge, environ cinq jours de voyage précédant la
naissance de Jésus, et peut-être un peu plus...
Une topographie et un itinéraire symbolique
Guidée
par Marie et Joseph, (représentant Israël attendant le Messie, comme
les Mages, qui représentent le reste de l'humanité, les deux groupes,
Jésus Marie et Joseph, et de (selon les noms traditionnels) l'autre
Gaspard, Melchior et Balthazar étant également en route sur le chemin de
Bethléem suivant au même moment par une étoile) l'âme humaine doit
parvenir, à la Crèche, à Dieu fait enfant, Vie, chemin et vérité, le
Fils du Dieu s'incarnant par Amour, pour mener les hommes vers la patrie
céleste, roi adoré par des rois, berger adoré par des bergers, pour
illuminer par le baptême les hommes et les sauver des ténèbres du péché
d'un monde ancien privé d'espérance: resté voilé pour les juifs,
tragique pour les grecs, ténébreux pour toutes les nations rendues
aveugles par le péché, l'idolâtrie, le paganisme, et rétablir l'homme
exilé depuis la chute originelle dans la vallée des larmes, dans le
Royaume des cieux. Marie porte alors en elle l'espérance de tous les
hommes :
« Il naît, non dans la maison de ses parents, mais dans un lieu étranger, et en voyage, parce que dans le mystère de son incarnation, il est devenu la voie qui nous conduit à la patrie (où nous jouirons pleinement de la vérité et de la vie) (Jn 14)...Chaque jour la sainte Église, à la suite de ses docteurs, se dégage du cercle toujours agité de la vie mondaine (ce que signifie le mot Galilée), pour venir dans la ville de Juda (c'est-à-dire de la confession et de la louange), et y payer au roi éternel le tribut de sa piété... »
— Bède
 Nazareth
Nazareth Galilée
Galilée Mont Garizim
Mont Garizim
Bethleem, lieu de la naissance du Christ
Il
n'existe pas de récit historique, pas de trace de l'itinéraire exact du
voyage de Marie, ni dans l'évangile de Saint Luc, ni ailleurs, pour que
resplendisse le sens symbolique de ce voyage au départ de Nazareth
vers : de l'ancien monde condamné à un dur labeur, depuis la faute
originelle, et de l'exil, vers le monde de la grâce ; de l'ancienne
Égypte où le peuple était en captivité, fin de l' exode vers la terre
promise (jeûne de 40 jours symbole des quarante ans d'errance, antiennes
symbole des 4 000 ans d'attente dans la prière) : en attente de
l'enfantement de Marie, dans l'attente d'Israël de la venue du Messie,
et attente de tous les hommes d'un salut après la chute originelle et
dans l'espérance d'un avenir et que jours précédant Noël illuminent
l'âme des hommes :

Le voyage vers Bethleem, fresque de l’église Sainte Marie, Foris, Castelseprio
Marie
et Joseph partent de Galilée, région appelée par Isaïe « carrefour des
nations », car symbole de l'agitation du « monde terrestre », (du
commerce international, des marchands, des occupations quotidiennes de
ce monde: la pêche, la garde des troupeaux, l'élevage, de
l'agriculture), de Nazareth, ancienne résidence princière, pour aller
dans le territoire de Juda et de Jérusalem, la ville du Temple de YHWH,
de l'absence de crainte, accompagné par les anges proclamant la paix, à
Bethléem symbole de la « patrie céleste », dont le nom signifie « maison
du pain » (du ciel ), car la naissance de Jésus dans une mangeoire doit
ensuite conduire à la « nourriture éternelle » de l'eucharistie.
Ce
voyage rempli d'espérance, que Marie et Joseph effectuent vers
Bethléem, Dieu invite tout homme à le faire, à travers les sentiers
étroits et resserrés des les montagnes, conduisant à la Vie éternelle, à
Jésus, symbole du danger de ce monde, et non la grande route, empruntée
par la multitude des voyageurs, symbole du chemin trop large du monde
de perdition, ni le désert symbole, du monde hostile et du démon pour
arriver à la terre promise de paix, de joie, de lumière, et à la gloire
du ciel.
Les
antiennes Ô dans les siècles ultérieurs, viennent mettre en lumière les
jours précédant Noël, les noms anciens du Dieu d'Abraham et de Jacob,
prié en chemin et Nazareth comme en toute Israël, et attendu par Marie
et Joseph, devenant leur enfant, l'incarnation d'un Dieu
incompréhensible dans une terre (leur terre), un clan ( de leur pays),
une lignée (leur lignée), une souche généalogique (l'arbre généalogique
de Marie), une humanité fraternelle (leur race), devenant Emmanuel (
« Dieu-avec-eux » sur les chemins de la vie).
« Ainsi
nous comprenons la sainte crainte qui t'assaillit quand l'ange du
Seigneur entra dans ta maison et te dit que tu mettrais au jour Celui
qui était l'espérance d'Israël et l'attente du monde. Par toi, par ton
« oui », l'espérance des millénaires devait devenir réalité, entrer dans
ce monde et dans son histoire. Toi tu t'es inclinée devant la grandeur
de cette mission et tu as dit « oui »: « Voici la servante du Seigneur;
que tout se passe pour moi selon ta parole » (Lc 1, 38). Quand remplie
d'une sainte joie tu as traversé en hâte les monts de Judée pour
rejoindre ta parente Élisabeth, tu devins l'image de l'Église à venir
qui, dans son sein, porte l'espérance du monde à travers les monts de
l'histoire. Mais à côté de la joie que, dans ton Magnificat , par les
paroles et par le chant tu as répandue dans les siècles, tu connaissais
également les affirmations obscures des prophètes sur la souffrance du
serviteur de Dieu en ce monde.. » « Benoît XVI , Spe Salvi »
Hugo van der Goes, Triptyque Portinari.
Marie et Joseph cherchant refuge à Bethleem.
Jan Matsys, « l'hospitalité refusée à Bethleem », 1558.
Haguenau, Retable de l'église Saint Georges, détail de la Nativité.
Vers
la venue du Sauveur : « Viens nous sauver, ne tardes pas » sera repris
ensuite dans l'évangile, par exemple en Luc 19:10 au sujet de Zachée, de
la race d'Abraham : «Alors Jésus dit à son sujet : Aujourd’hui, le
salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d’Abraham.
En effet, le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était
perdu. » Au jour de Noël, la liturgie commence par ce « Hodie » de l'
« aujourd'hui » de Dieu Eternel, Adonaï, Sagesse éternelle, entré dans
le temps.
Dom Guéranger

Santon représentant la Vierge Marie enceinte du Christ
Plus
que tout autre Dom Prosper Guéranger sut mettre en parallèle son
commentaire des antiennes dans l'Année liturgique, avec le voyage de
Marie vers Bethléem (cf. « L' Avent liturgique », antienne par
antienne : [lire en ligne]) :
« (...) cette Femme inconnue des hommes et chérie du ciel, étant arrivée au terme du neuvième mois depuis la conception de son fils, enfante à Bethléhem ce fils dont le Prophète a dit : « Sa sortie est dès les jours de l'éternité ; ô Bethléhem ! tu n'es pas pas la moindre entre les mille cités de Jacob ; car il sortira aussi de toi ». Vous voici donc en marche, ô Fils de Jessé, vers la ville de vos aïeux. Voici que vous traversez la Judée ; vous approchez de Jérusalem ; le voyage de Marie et de Joseph tire à son terme. Sur le chemin, vous rencontrez une multitude d'hommes qui marchent en toutes les directions, et qui se rendent chacun dans sa ville d'origine, pour satisfaire à l'Edit du dénombrement. De tous ces hommes, aucun ne vous a soupçonné si près de lui, ô divin Orient ! O Fils de David, héritier de son trône et de sa puissance, vous parcourez, dans votre marche triomphale, une terre soumise autrefois à votre aïeul, aujourd'hui asservie par les Gentils. O Roi des nations ! vous approchez toujours plus de cette Bethléhem où vous devez naître. O Emmanuel ! Roi de Paix ! vous entrez aujourd'hui dans Jérusalem (...) Maintenant, vous pénétrez sans bruit et sans éclat dans cette ville de David et de Salomon. Elle n'est que le lieu de votre passage, pour vous rendre à Bethléhem »
— Dom Prosper Guéranger, Année Liturgique, « Avent »
Contexte historique
La
fête de l’Attente et de l’Espérance, (Expecato) devenue « fête des Ô de
Noël» est une fête d'origine espagnole du Royaume des wisigoths
nouvellement chrétien. Pourtant les Ô n'apparaissent pas dans les
antiphonaires et la liturgie mozarabe.
Article détaillé : Les « Ô » en Espagne.
Manière de les chanter
Importance de l'élan mélodique de la syllabe « Ô »
Comme
la nature de ce chant est complètement différente de la musique
contemporaine, il faut consulter les notations anciennes, notamment
celle de l'antiphonaire de Hartker, en faveur de l'interprétation
correcte de ce chant artistique. La notation à gros carrés, à droite,
reste utile pour le solfège. Dans la notation de Hartker, les neumes
attribués à la syllabe « Ô » sont identiques [lire en ligne]
alors que les versets varient en raison des textes différents et de
leur accentuation. Cet « Ô » n'est pas une simple introduction. Il
s'agit d'une première mélodie importante, avec la valeur du terme « Ô »
accentué.
Selon
les notations authentiques, la mélodie « Ô » se compose de quatre
notes : Ré - Fa - Fa - Mi (mélodie identique dans la notation à droite,
La (3 x ½) Do (=) Do (½) Si
selon la clef C (= Do), mais à l'époque de la composition du chant
grégorien, le demi-ton Si n'existait pas encore.). Les deux premières
notes sont déjà vraiment importantes. En effet, les Ré et Fa ne sont
autres que les deux tons principaux du deuxième mode (Protus plagal),
plus précisément le ton final (Ré, voir le terme prudentiæ à la fin)
ainsi que le teneur (Fa). À savoir, la couleur de toutes ces grandes
antiennes est déterminée avec ce premier élan Ré - Fa. En conséquence,
il faut chanter soigneusement ces notes, en précisant le mode II. Il
s'agit du mode employé dans toutes premières antiennes « Ô ».
De plus, il faut une articulation raffinée pour ces deux notes. Le copiste sangallien écrivit un pes rond épisémé ( ),
qui indique l'importance de la deuxième note. L'élan se commence, avec
une note moins importante (il s'agit d'une caractéristique du chant
grégorien, au contraire de la musique moderne qui pose toujours le
rythme principal à la première note) et se développe vers la deuxième
note. Dans les manuscrits de Saint-Gall, ce neume était fréquemment
attribué aux mots importants.
),
qui indique l'importance de la deuxième note. L'élan se commence, avec
une note moins importante (il s'agit d'une caractéristique du chant
grégorien, au contraire de la musique moderne qui pose toujours le
rythme principal à la première note) et se développe vers la deuxième
note. Dans les manuscrits de Saint-Gall, ce neume était fréquemment
attribué aux mots importants.

Moines franciscains, chantres, au lutrin. Lombardie, 1470-1471
Cette
tension mélodique se continue encore, en faveur de la troisième note à
l'unisson, sommet de cet élan. Le notateur de Saint-Gall ajoutait une
lettre significative t à toutes les premières huit antiennes, afin
d'allonger la troisième note. Désormais, ces deux sons principaux Ré et
Fa assurent l'unité architecturale en tant qu'axes. D'autres notes dans
les élans suivants ne sont autres que les ornements sur l'axe Ré, puis
celui de Fa, d'après la notation.
La
quatrième et dernière, Mi, est une note de détente partielle en
demi-ton, pour la préparation de l'élan suivant. Le copiste employait un
neume particulier, pressus minor qui signifie l'unisson suivie d'une
note légèrement basse. Même si cette note un peu basse n'est plus
sommet, Dom Eugène Cardine de Solesmes considérait qu'il s'agit
également d'une note soulignée, en dépit d'une ambiguïté rythmique de ce
neume. En résumé, on doit chanter attentivement cet élan « Ô » avec un
raffinement artistique.
Par
ailleurs, ce motif en mode II Ré - Fa - Fa - Mi, très solennel, n'est
pas étrange. Celui-ci se trouve dans quelques chants des prêtres de la
messe en forme extraordinaire, notamment juste avant le Pater noster : Per ipsum, et cum ipso. Même après le concile Vatican II, on conserve cette mélodie en langue vulgaire.
Pratiques en dehors des célébrations de l'Avent

Breviarium antiquissimum, folio 79r. avec les antiennes O. (cliquer pour agrandir). Voir aussi son manuscrit en ligne
En
certains établissements religieux, on chantait les grandes antiennes
« Ô » au cantique final des laudes, lors de l'exécution du Benedictusds,
tout comme auprès du Saint-Siège. Ainsi, dans le manuscrit du
Breviarium antiquissimum, 11 grandes antiennes « Ô » se plaçaient Post
benedicam. D'ailleurs, l'antienne « O Virgo Virginum », qui devait
disparaître, ne se trouve qu'à la fin, à savoir la onzième :
- 11 antiennes « Ô » dans le Breviarium antiquissimum (premier tiers du XIIIe siècle), folios 79r et 79v, Ms. 103 auprès de la bibliothèque de l'abbaye d'Engelberg [manuscrit en ligne]
On
les répétait même après chaque verset à partir de In sanctitate et
Justitia jusqu’au Gloria. « Le Benedictus est le cantique de Zacharie ;
le rapprochement avec le grand personnage de l’Avent, Jean le Baptiste, a
peut-être attiré le chant de ces antiennes en ce moment, d’autant plus
que deux d’entre elles « O Clavis (Ô Clef) » et « O Oriens (Ô Aurore) »
reprennent les termes des derniers versets du cantique Benedictus. »
D'ailleurs,
certains les chantaient après le Rorate. On faisait « triompher les
antiennes Ô », c'est-à-dire qu'elles étaient chantées trois fois, après
le Magnificat et le chant de l’antienne était alors repris à chaque
reprise entre les versets de ce cantique marial, ou bien avant le
Magnificat, avant et après le Gloria Patri. Elles étaient chantées selon
des règles précises, mentionnées par exemple dans le Chapitre de la
cathédrale d'Amiens au XIIIe siècle : l'évêque devait les entonner,
ensuite le grand chantre et pas le chœur, en cape noire, rouge ou
blanche.
« Prendre l'antienne » et « Faire un Ô »

Trois
moines au repas de vêpres, Adolf Humborg : le jardinier tend ses
« racines » (radices) lesquelles étaient souvent la nourriture des
moines végétariens.

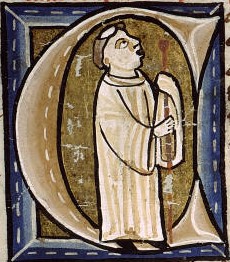

O Clavis David

O Radix Jéssé
« Prendre
l'antienne » signifiait entonner l'antienne. « Imposer l'antienne »
signifiait donner le ton ou le texte. Un ancien récit nous raconte
comment les antiennes étaient entonnées. Dans quelques églises, le
chancelier chargé des écoles du diocèse dispensant les cours de science
entonnait la première Antienne de Magnificat Ô Sapientia. Le Doyen
entonnait la seconde antienne Ô Adonaï parce que ce mot était
l’anagramme de « Adonaï » ou à cause des paroles de l’antienne Dux domus
Israël, parce qu’il était le chef du Chapitre.
Le
Chantre à cause de son bâton cantoral en forme de tige, entonnait la
troisième antienne O Radix Jessé ou à cause des paroles qui stat in
signum populorum car c’est lui qui surveille avec son bâton, l’assemblée
à l’église, et le peuple, de bien psalmodier et de se comporter
modestement. Le Trésorier qui gardait les clefs du trésor de l’église,
commençait Ô Clavis David et l’Archidiacre, dont la juridiction
spirituelle comprenait un territoire situé à l’orient d e la cathédrale
entonnait Ô Oriens, le Grand Archidiacre dont la juridiction s’étendait
sur ville et campagne, Ô Rex gentium parce que des deux, ville et
campagne, il ne faisait qu’un, facit utraque unum.
L'évêque du lieu entonnait la dernière, par exemple Ô Pastor Israël pour l'archevêque de Paris.
Dans
les monastères, et ailleurs en France (Fleury) et en Angleterre
(Battle, Westminster), l'ordre de les chanter était un peu différent
mais tout aussi symbolique : Ô Sapientia était chantée selon les lieux
(dans l'ordre : 1. Fleury, 2. Rouen, 3. St Edmund) par (1) l'Abbé, (2)
le Chancelier,(3] le Sénéchal ou le Prieur, Ô Adonai par le Prieur, ou
le Cellerier, qui gardait les clefs, Ô Radix Jesse, racine de Jéssé, par
le Jardinier (hortulanus), le Chantre ou le Sacristain, O Clavis David
par le Cellerier, Trésorier ou Chamberlain O Oriens , par le Trésorier,
l'Archidiacre ou le Pitancier. Chacun recevait un peu d'argent dont les
comptes des monastères gardent les traces et qui contribuait sans doute à
financer la fête : « pour l’OO du Jardinier ». Ô étaient appelée encore
« Olla ». On parlait de l’ Ô du prieur ou Ô du sous-prieur car l'Ô
prenait le nom de la personne qui l'avait entonnée ce qui était un grand
honneur, comme aussi de l'OO : 'l’OO du jardinier, l'OO du sacristain.
Chacun devait faire une fête le jour de son « Ô » et en cela se montrer
très généreux et pourvoir abondamment à ce festin ou collation. Le
Cellerier devait procurer du pitance de bon vin. Souvent, chacun allait,
après la procession, chez le Prieur, boire un « triple coup de vin »
(les O étaient entonnées trois fois) : blanc, rose et rouge. Le
jardinier devait donner des produits de son jardin, épices ou fruits et
légumes, et, quittant ses bottes et sa cape, partait entonner l'Ô. À
Durham, le maître des novices offrait un festin de figues, d'ale, de
raisin, de gâteaux.
Article détaillé : Traditions des antiennes Ô.
Ces
petites agapes vespérales succédaient au jeûne du Carême de l'Avent. En
Jésus, Dieu venait s'incarner, mangeant et buvant, selon les évangiles.
Le son des cloches

Les nouvelles cloches de la cathédrale Notre-Dame de Paris
Dans
les couvents et les monastères, on faisait autrefois « Sonner l'O »,
sonner la grosse cloche pendant toute la durée du chant des antiennes Ô,
puis pendant la collation au réfectoire, et aussi dans les églises des
villages, les cathédrales, pour que tous les habitants du village soient
avertis de la joie de Noël.
De
nos jours, du 17 au 23 décembre, le « Plenum Nord » c'est-à-dire
l'ensemble des huit cloches sonnant à la volée à Notre-Dame de Paris,
sonne pendant les Vêpres, au moment du chant des « grandes antiennes Ô
».
Attente lumineuse de la fête de Noël

Cathédrale de Chartres, Grande rosace, Christ en majesté. « Le Saint-Sacrement était exposé au centre de ce cercle rayonnant »

Rosace de la Cathédrale de Chartres, avec les douze prophètes (cliquer pour agrandir et les identifier)
Pour
l'avent dont la durée est de quatre dimanches une fête des lumières est
en place sur la symbolique (ordinaire) lumière et paix. (Elle est pour
les chrétiens la « lumière de la foi » (avec la prière) qui est associée
au diptyque « justice (divine) et paix » reproduit ordinairement dans
l'architecture chrétienne et les cercles de lumières des vitraux
comprenant les images des patriarches, des prophètes et de l'histoire
sainte).

Historiquement
on plaçait sur le tabernacle ou sur l'autel un cercle de métal poli,
déviant un peu de la ligne perpendiculaire. Sur les parois intérieures
de ce cercle étaient ménagées plusieurs lances ou chevilles, sur
lesquelles on implantait des cierges allumés, un par jour, comme les
quatre cierges de l'Avent, jusqu'à ce que la totalité des antiennes
soient chantées. Ces bougies et ces flammes faisaient de Noël une « fête
des lumières », bien avant l'invention des Couronnes de l'Avent mais
symbolisait surtout comme les bougies de l'Avent l'Attente de la fête de
Noël par tous les chrétiens, l'Église, le clergé, les paroissiens, et
surtout, par les enfants.
Ces
cierges et ces flammes symbolisaient également la parole des prophètes
comprise dans les antiennes : « Nous avons un témoignage plus sûr que
cette vision du Thabor, ce sont les paroles des prophètes, auxquelles
vous faites bien de vous attacher comme au flambeau qui brille dans un
lieu obscur. (2° épître de saint Pierre, 1:19) ».
Le Saint-Sacrement était exposé au centre de ce cercle rayonnant.
Cette coutume est remplacée aujourd'hui par les quatre bougies de l'Avent d'un symbolisme identique à celui des antiennes Ô.
Au
XVIe siècle un récit nous rapporte que durant le chant des antiennes, à
Sens, on approchait de l'aigle du lutrin ou de l'ambon, de deux croix
d'argent avec deux torches embrasées, pour les éclairer afin d'accroitre
la joie liée au culte divin. Un vers transmis Raoul de Rouvray montre
le lien entre la fête de la Sainte Lucie et les bougies de l'avent des
antiennes Ô : « Tu dona festum Nichasi Luce sequente, Dici festum nisi
Luce sua, Nam sua decet « O » festum Luce referetur » : « La fête de
Nichaise suit celle de Lucie, pas de fête dit-on sans Lumière, En effet
le convient de relier les O à la fête de sa Lumière. »
Article détaillé : Avent.
 Siège de la Sagesse
Siège de la Sagesse

Racine de Jéssé

Le roi David, Troyes
Une préparation au baptême

Baptême de Clovis, détail, ivoire, IXe siècle
Ces
lumières étaient aussi comme le signe du soir qui tombe, des vêpres,
comme à Pâques, le symbole de l' illumination baptismale, un cheminement
vers Jésus, qui est la Vérité, et la Lumière comme le dit par exemple
l'antienne Ô Oriens : L'usage ancien était en effet autrefois, de
baptiser également à la veille de Noël les catéchumènes. Clovis fut
baptisé ainsi et une légende ancienne, rapporte que le baptistère de
Marcellin, évêque d'Embrun, se remplissait d'eau miraculeusement pour la
Nativité. Les aveugles, entendant les antiennes, s'ils ne voyaient les
vitraux des Cathédrales, comprennaient, d'où l'importance de la
liturgie.
- « Jusqu'à la consommation des siècles, le Seigneur ne cesse point d'être conçu à Nazareth, de naître à Bethléem ; en effet, chacun de ses disciples qui reçoit en lui la fleur du Verbe, devient la maison du pain éternel ; chaque jour encore, il est conçu par la foi dans un sein virginal, (c'est-à-dire dans l'âme des croyants), et il est engendré par le baptême. » (Bède)
Attente du Salut
On
peut remarquer que le Cantique de Zacharie , qui suit dans l'évangile
de Luc, le cantique du Magnificat, contient le thème des antiennes Ô : Ô
Oriens et, O Clavis David.
Les
antiennes jointes au Magnificat ( Salut annoncé à nos Pères en faveur
d'Abraham et sa race à jamais) font un écho de la prédication
évangélique de Jésus, lorsqu'il dit à Zachée partageant son bien (Luc,
15:9) : « Aujourd’hui, le « salut » est arrivé pour cette maison, car
lui aussi est un fils d’« Abraham ». En effet, le Fils de l’homme « est
venu » chercher et « sauver » ce qui était perdu. »
À travers le monde
En Espagne, au Portugal et en Amérique Latine
Les antiennes seraient peut-être apparues en Espagne liées à la fête de l'Expectacion, comme on l'a vu plus haut.
Article détaillé : Les « Ô » en Espagne .
En Angleterre
Article détaillé : Les « Ô » en Angleterre.
En Allemagne, Belgique, Pays-Bas
En
Allemagne et à Liège on rajoutait comme à Paris deux antiennes. En
Belgique et aux Pays-Bas, la « Messe d'or », ou Gulden miss, vers le 18
décembre, le mercredi des quatre temps, fêtait l' Annonciation, en plus
de la fête de sainte Marie des O, ou fête de l'Expectation : les deux
fêtes étaient bien distinctes.
En Italie
En France
France contemporaine
La
liturgie contemporaine de Taizé a gardé la tradition de chanter les
antiennes les vendredi de l'Avent. Elles sont incluses et citées dans l'
Hymnal Companion 1940 et dans l'Office Divin de chaque jour(Neuchâtel),
en français : ainsi que dans tous les monastères, et communautés
religieuses monastiques, grégoriennes ou non.
Dans le monde entier
Article détaillé : Liste des églises Notre-Dame de l'Ô .
Plusieurs
églises dans le monde portent ce nom de « Nuestra-Señora de la Ô »
liées à la Fête de l'Attente, de l'Expectation de la Vierge et de
l'Espérance
Statuaire

Nuestra Señora de la Ô, Navas de Madroño
On trouve en Europe, à partir du XII e jusqu'au XVI siècle, et principalement au XV
siècle, des statues de la Vierge enceinte, « Notre-Dame de l'Ô » de
Marie sous le nom de « Vierge enceinte de l'Expectation », Expectatio B.
M. Virginis, « de l'Attente », « de l'Espérance », « Notre-Dame la
Blanche », « Maria gravida », « Madonna del parto », « Virgo paritura » ,
debout, assise, couchée, avec parfois une représentation en
transparence de l'enfant Jésus dans son ventre, appelée aussi « Vierge
de l'Avent » ou « Vierge des Avents » en France. En Allemagne, Maria in
der Hoffnung, von der guten Hoffnung, Maria Erwartung , en Angleterre
par Lady of Expectation, en Italie, Madonna del Parto, Vergine
partoriente, en Espagne et en Catalogne, N. Señora de la Expectatión,
Virgen de la Esperanza, de la O, au Portugal, Senhora do O.
En décembre 563 le concile de Trente, lors de sa 25e et dernière session, décrète ceci :
- « Le saint concile défend que l'on place dans une église aucune image qui rappelle un dogme erroné et qui puisse égarer les simples. Il veut qu'on (...) ne donne pas aux images des attraits provocants ». Cette représentation iconographique des rondeurs de la Vierge tombera par la suite en désuétude.
Article détaillé : Vierges enceintes .
Musique : adaptations
Article principal : Liste d'œuvres musicales ayant pour thème les Antiennes Ô de l'Avent.
Le Mystère de Noël

Le Nouveau-né, Georges de La Tour, 1648
« Du 17 au 24 décembre, ce sont ensuite les grandes antiennes « O » du Magnificat : O Sagesse, O Adonaï, O Fils de la race de Jessé, O Clé de la Cité de David, O Orient, O Roi des Nations qui, avec une ardeur et une ferveur grandissantes, lancent leur appel : Viens pour nous sauver. Et toujours plus pressante, retentit la promesse : Voyez, tout est accompli, et finalement : Sachez aujourd'hui que le Seigneur vient, et demain vous le verrez dans sa gloire.
Lors de la veillée, quand scintille l'arbre de lumière et que s'échangent les cadeaux, le désir inassouvi d'une autre lumière monte en nous, jusqu'à ce que sonnent les cloches de la messe de minuit et que se renouvelle, sur des autels parés de cierges et de fleurs, le miracle de Noël. Et le Verbe s'est chair. Nous voilà parvenus à l'instant bienheureux où notre attente est comblée. »
— Le mystère de Noël , conférence d' Edith Stein, Janvier 1931
Source :







Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire